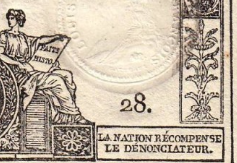Tout savoir sur l’uniforme des gardes champêtres particuliers
- Grégory Cludts

- 27 juil. 2025
- 5 min de lecture
Dernière mise à jour : 31 juil. 2025
Pourquoi avoir prévu l’obligation d’un uniforme ? Les gardes champêtres particuliers doivent-ils porter leur uniforme uniquement lors de leurs missions ? Cet uniforme peut-il présenter des différences notables entre gardes ? Enfin, un garde champêtre particulier sans uniforme peut-il se prévaloir de sa qualité et dresser procès-verbal ?
1. Pourquoi un uniforme pour les gardes champêtres particuliers ?
Le Ministre de l’Intérieur, compétent en la matière, a justifié de manière lumineuse l’obligation du port d’un uniforme :
« les gardes champêtres particuliers doivent pouvoir être reconnus par le public. Il est en outre important que les gardes champêtres particuliers puissent se distinguer d’une part des autres citoyens – en raison de leurs compétences policières – et d’autre part des fonctions des autres personnes en uniforme qui peuvent être actives sur le même terrain – gardes forestiers, police,… »[1].
Un uniforme spécifique permet effectivement de faire face à deux difficultés pratiques bien connues.
Premièrement, les chasseurs d’un territoire de chasse font souvent appel à une personne, parfois l’un d’eux, parfois un tiers, pour les aider à gérer ce territoire. Les termes « garde-chasse » voire « garde privé » sont alors parfois utilisés et peuvent prêter à confusion avec celui de garde champêtre particulier. Sauf interdiction spécifique[2], rien n’interdit à ce « garde-chasse » de « surveiller » le territoire, mais pour autant qu’il se souvienne qu’il ne possède aucun droit ou prérogative autre que le commun des citoyens. Le garde champêtre particulier, lui, est revêtu d’un uniforme, ce qui manifeste d’emblée sa qualité et son statut d’officier de police judiciaire, contrairement à la personne dite « garde-chasse » qui ne peut porter aucun uniforme officiel.
Deuxièmement, la distinction entre garde champêtre particulier et agent du Département de la Nature et des Forêts n’est pas aisée pour bon nombre de citoyens, en dépit de la plupart des différences dans les pièces d’uniforme. Toutefois, un citoyen interpellé par l’un de ces deux officiers de police judiciaire ne devrait pas rester longtemps dans le doute puisque :
des inscriptions différentes et explicites sont visibles sur les uniformes, voire aussi sur les véhicules de fonction (« Nature et forêts[3] » - « SPW » vs. « Garde Champêtre particulier ») ;
un officier de police judiciaire doit annoncer sa qualité dès qu’il interpelle un citoyen.
L’importance d’être directement identifiable justifie aussi l’obligation de porter un uniforme strictement réglementaire, complet et sans « fantaisie ». Citons pour exemple :
Pour ne pas risquer d’être dans l’illégalité, il est important de s’approvisionner directement auprès de l’association représentative des gardes (AGPRW) qui assure la vente de pièces d’uniforme certifiés réglementaires. Le lecteur curieux trouvera dans les illustrations de cette même page web des exemples d'un garde champêtre particulier revêtu d'un uniforme réglementaire.
2. Quand porter son uniforme ?
La réglementation applicable aux gardes champêtres particuliers[7] impose que l’uniforme soit obligatoirement mais uniquement porté :
lors de l’exercice des missions professionnelles telles que décrites dans le Code rural ;
lors des déplacements domicile-travail ;
lors des déplacements entre deux ou plusieurs domaines pour lequel le garde champêtre particulier est commissionné ;
durant le recyclage ;
durant l’examen de recyclage ;
pendant les déplacements domicile-centre de formation.
Il existe une exception : « moyennant autorisation expresse et préalable du gouverneur, l’uniforme peut être porté pendant des évènements particuliers ».
3. Que peut faire le garde face à une infraction s’il n’est pas en uniforme ?
A l’attention des lecteurs peu au fait de certaines réalités rurales, précisons qu’il est envisageable et non répréhensible qu’un garde champêtre particulier ne soit pas systématiquement en uniforme sur son territoire. Citons comme exemple :
la situation des gardes qui habitent à proximité ou au sein de leur territoire (les circonstances de la vie quotidienne expliquent qu’ils ne soient pas en uniforme chaque fois qu’ils franchissent le seuil de leur porte) ;
la situation des gardes qui doivent revêtir des vêtements de sécurité vu la multitude des travaux qu’ils peuvent être amenés à effectuer en plus de la surveillance (ex. : bûcheronnage, entretien des lignes de tir, etc).
Toutefois, s’il surprend une personne en infraction, le garde champêtre particulier sans uniforme redevient un simple citoyen vis-à-vis du délinquant présumé. Il doit s’abstenir de se prévaloir de sa qualité. La Cour de cassation a en effet jugé « qu’un garde champêtre particulier ne peut, en règle, se prévaloir de l’exercice de sa fonction de garde champêtre particulier que lorsqu’il porte les signes extérieurs prescrits attachés à cette fonction »[8].
Confronté à une situation infractionnelle, le garde champêtre non revêtu de son uniforme ne peut se prévaloir de sa qualité et ne pourra donc pas non plus dresser procès-verbal. Il n’est pas pour autant démuni car deux moyens d’actions s’offrent à lui :
celle que tout citoyen possède de dénoncer des faits aux autorités (police, DNF, UAB) ou au Procureur du Roi[9] ;
celle que tout officier de police judiciaire possède, même lorsqu’il n’est pas lui-même compétent pour dresser un procès-verbal de constat. Le garde champêtre particulier peut alors aviser le Procureur du Roi par un procès-verbal d’information[10]. Le Procureur du Roi pourra alors décider s’il ouvre une enquête, qu’il confiera à d’autres agents.
Grégory Cludts, avocat
[1] Rapport au roi sur l’adoption de l’arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers (M.B., 24 février 2006, 3e éd., p. 10046). Ce que la cour de cassation a résumé en jugeant que : « l’obligation légale et réglementaire du port de l’uniforme [vise à] d’assurer le caractère reconnaissable des gardes champêtres particuliers et de garantir la distinction, d’une part, entre les gardes champêtres particuliers et, d’autre part, les citoyens et autres forces de l’ordre en uniforme, qu’un garde champêtre particulier ne peut, en règle, se prévaloir de l’exercice de sa fonction de garde champêtre particulier que lorsqu’il porte les signes extérieurs prescrits attachés à cette fonction » (Cass. (2e ch.), 19 septembre 2017, P.16.1101.N/1, p. 5).
[2] Voir notre article Le garde champêtre particulier : toujours utile, parfois obligatoire !
[3] Les agents de l’Unité Anti-braconnage du Département de la Police et des Contrôles, arborent eux un sigle gris « D.P.C. – U.A.B. ».
[4] Article 16 de de l’arrêté royal du 10 septembre 2017 règlementant le statut des gardes champêtres particuliers, tel que modifié par l’article 2 de l’arrêté royal du 8 juillet 2019 modifiant l’arrêté royal du 10 septembre 2017 réglementant le statut des gardes champêtres.
[5] Articles 16 et 17, § 1er, 3e tiret, et Annexe 2 de l’arrêté royal du 10 septembre 2017 règlementant le statut des gardes champêtres particuliers.
[6] Article 16, dernière phrase, de l’arrêté royal du 10 septembre 2017 règlementant le statut des gardes champêtres particuliers.
[7] L’article 15 de l’arrêté ministériel du 10 juillet 2019 exécutant l’arrêté royal du 10 septembre 2017 règlementant le statut des gardes champêtres particuliers.
[8] Cass. (2e ch.), 19 septembre 2017, P.16.1101.N/1, p. 5.
[9] Article 30 du Code d’instruction criminelle : « Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où l'inculpé pourra être trouvé. »
[10] Article 29 du Code d’instruction criminelle : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public (…) qui, dans l'exercice de ses fonctions acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu de donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs »