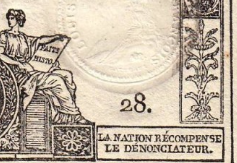La production de la carte d’identité sur réquisition du garde champêtre particulier
- Grégory Cludts

- 10 juin 2025
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 22 juil. 2025
Le garde champêtre particulier peut-il requérir la présentation d’une pièce d’identité ? Et si oui, dans quelles conditions ?
La question ne se pose que si, préalablement, le garde champêtre particulier se trouve dans l’exercice de ses missions sur son territoire, revêtu de son uniforme et porteur de sa carte de légitimation. A défaut, il ne peut se prévaloir de sa fonction.
La matière est régie par l’arrêté royal du 25 mars 2003 relatif au cartes d’identité :
« Tout Belge âgé de quinze ans accomplis doit être porteur d'une carte d'identité valant certificat d'inscription au registre de la population (…).
L'un ou l'autre de ces documents doit être présenté à toute réquisition de la police ainsi qu'à l'occasion de toute déclaration, de toute demande de certificats et, d'une manière générale, lorsqu'il s'agit d'établir l'identité du porteur[1] ».
Au sens de cette disposition, le garde champêtre particulier est-il assimilé à « la police » ? Nous pensons pouvoir répondre par l’affirmative, eu égard au terme général de « police » employé dans cette règlementation, d’une part, et, d’autre part, au vu de la raison d’être de cette possibilité de réquisition[2]. De plus, en vertu des articles 61 du Code rural et 17 du Code d’instruction criminelle, le garde champêtre particulier a la qualité d’officier de police judiciaire sur son territoire[3]. C’est en cette qualité que le garde peut requérir la présentation d’une pièce d’identité. A l’occasion d’une réponse à une question parlementaire, le ministre de la Justice est parvenu à la même conclusion[4].
Le garde champêtre particulier ne procédera à la réquisition de la présentation de la carte d’identité que si la personne a commis une infraction qu’il est habilité à constater, ou s’il a des raisons de croire qu’elle s’apprête à la commettre. La faculté de se voir produire une carte d’identité n’implique pas celui de la conserver : elle doit être restituée dès que l’identité est établie.
Quant à la sanction, le refus de présentation est puni « d'une amende de vingt-six à cinq cents euros » (augmenté des décimes additionnels)[5]. Encore faut-il parvenir à l’identifier ultérieurement. Il n’est pas inutile de préciser qu’en cas de refus, la prise de photos ou vidéos, destinées uniquement à permettre à la police d’identifier l’individu, poursuit une mission d’intérêt public (la répression d’une infraction) et, comme telle, ne viole pas la loi sur la vie privée[6].
Grégory Cludts, avocat
[1] Article 1er, alinéa 2.
[2] Ces remarques peuvent valoir identiquement pour ces autres OPJ que sont les agents du D.N.F. et de l’U.A-B., qui n’appartiennent pas non plus à la police locale ou fédérale.
[3] Voir not. Cass., 5 novembre 1936, Pas., 1936, pp. 406-407 ; Cass. (1er ch.), 23 février 1939, Pas., 1939, pp. 91-94.
[4] Bull. des questions et réponses écrites, n° B40, législature 47, p. 9003. La compétence relative au statut des GCP relève du ministre de l’Intérieur. Le ministre de la Justice a répondu à la question posée parce qu’elle relevait aussi de sa compétence.
[5] Article 7 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour.
[6] Précisément, la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dont l’article 74 porte : « Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l'un des cas suivants : (…) 4° lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou une autorité publique à laquelle les données à caractère personnel sont communiquées ».